Dossier Laméca
Le gwoka.
Entre anticolonialisme et post-colonialisme
5. JAZZ ET GWOKA : AURALITÉ CRÉOLE OU DIASPORIQUE ?
|Intro : Imaginaires géographiques du gwoka|
|Nationalisme, créolité et diasporicité|
|Gérard Lockel entre nationalisme et cosmopolitisme diasporique|
|David Murray et les Gwo Ka Masters : Décalages dans l’esthétique du blues|
|Jazz Ka : Créolisation de la diaspora|
|Conclusion|
|Coda|
Intro : Imaginaires géographiques du gwoka
La musique porte une géographie et cette géographie participe d’une certaine façon de se penser au monde. Le gwoka peut être vécu à travers trois imaginaires géographiques différents. Le premier est le moins controversé : le gwoka est la musique nationale de la Guadeloupe. Il est la représentation sonore d’une culture spécifiquement guadeloupéenne. La musique de Gérard Lockel illustre le plus clairement cet imaginaire géographique nationaliste, fruit du mouvement indépendantiste (voir 3. Le gwoka comme auralité anticoloniale). Le deuxième imaginaire géographique du gwoka s’ouvre sur la diaspora africaine. On peut comprendre cette proposition de deux façons. D’une part, on peut entendre le gwoka comme une musique noire qui continue de véhiculer une grammaire esthétique dont les origines remontent vers l’Afrique de l’Ouest. D’autre part (et ces deux approches se recoupent souvent et se complémentent), on observe que le gwoka participe à la circulation d’esthétiques au sein de musiques de la diaspora qui lui sont contemporaines : influences, par exemple, des musiques cubaines, de la soul, de l’Afrobeat (voir 4. Les deux créolisations de Guy Konkèt), ou, comme nous allons le voir, échanges avec le monde du jazz. Enfin, le gwoka peut être compris comme une musique créole, qui partage une histoire, des esthétiques et des références privilégiées avec d’autres musiques issues des sociétés coloniales esclavagistes qui, comme lui, sont les résultats divers et imprévisibles d’une rencontre entre musiques européennes, africaines et amérindiennes, elles-mêmes comprises comme diverses et déjà syncrétiques.
Ces trois imaginaires coexistent, souvent en tension l’un envers l’autre, dans le monde du gwoka. Les rencontres entre jazz et gwoka amplifient à la fois les points de convergences et les dissonances. Je propose ici d’examiner trois exemples. D’abord, je souhaite revenir sur le gwoka modèn de Gérard Lockel pour éclairer la tension entre des éléments esthétiques empreints de ce qu’on peut appeler un certain cosmopolitisme diasporique et son idéologie nationaliste. Dans un deuxième temps, la rencontre entre David Murray et les Gwo Ka Masters montre comment une esthétique du blues partagée par des musiciens afro-descendants peut permettre une certaine intimité diasporique tout en révélant les décalages inhérents à cette « performance » (au sens anglais et philosophique du terme : représentation ou mise en pratique qui rend réel, qui donne vie à l’objet représenté) de la diaspora. Enfin, le jazz ka illustre une créolisation de la diaspora, c’est-à-dire une position qui prend le métissage comme point de départ et qui opère un décentrage de la diaspora de l’Afrique vers les Amériques.
Nationalisme, créolité et diasporicité
Pour comprendre l’analyse qui suit, il faut faire la part des choses entre diaspora et créolisation en tant que théories issues des sciences sociales pour conceptualiser l’émergence de cultures afro-américaines et ce qu’on peut appeler la diasporicité et la créolité en tant que revendications identitaires, façons de se construire, de se penser comme sujet dans les sociétés post-esclavagistes.
Les concepts de diaspora et de créolisation ont des histoires intellectuelles longues et complexes que je vais tenter de rapidement résumer ici (Cohen 2007). Le concept de diaspora met l’accent sur la dispersion d’un peuple depuis un point de départ géographique, la dispersion des peuples juifs et arméniens servant de référence. La diaspora implique deux choses : la possibilité d’un retour – imaginaire à défaut de pouvoir être physique – vers le point de départ historique et le maintien d’une unité culturelle malgré la dispersion (Chivallon 1997; Clifford 1997). Par contraste, le principe de créolisation met l’accent sur l’hybridité et le métissage. Issue de la recherche sur les sociétés post-esclavagistes aux Amériques (Palmié 2006; Palmié 2007a; Palmié 2007b), il extrapole depuis ce qu’on peut connaitre des dynamiques de création culturelle au sein des communautés de marrons (dans le travail de Sydney Mintz et Richard Price (1992), en particulier) ou en marge de la plantation (Trouillot 2002). Pour Edouard Glissant, la créolisation brouille les traces des origines et ne permet un retour que vers un point d’enchevêtrement. La créolisation met donc l’accent sur la discontinuité, la mixité, et la diversité de ses résultats (sans pour autant, chez Glissant, nier la réalité de l’existence de différentes identités culturelles, toujours et encore dynamiques, issues des processus de créolisation).
Deux points importants sont à retenir quant à l’utilisation de ces concepts dans les études des sociétés et cultures noires aux Amériques. D’abord, l’approche diasporique comme l’approche créoliste reconnaissent l’existence de « rétentions africaines » dans les cultures noires américaines mais elles le font en privilégiant deux références géographiques et temporelles différentes : l’Afrique pour ce qui est de la diaspora, la plantation esclavagiste pour ce qui est de la créolisation. L’anthropologue David Scott fait aussi remarquer que, même si les chercheurs ne l’ont pas toujours reconnu ouvertement, ces études des sociétés et cultures noires américaines soutiennent et participent à différents projets politiques, à différentes façons d’affirmer la subjectivité (la capacité de se penser en tant que personne) et l’agentivité (la capacité d’agir sur le monde) des peuples noirs (Scott 1991). Penser la diaspora, c’est mettre en valeur des connaissances et des pratiques qui prédatent le colonialisme et l’esclavage. La créolisation, elle, permet de célébrer le génie créateur des personnes mises en esclavage. En cela la recherche fait écho aux contextes politiques dans lesquels elle prend place. On ne peut, par exemple, ignorer les liens entre la Renaissance de Harlem et les travaux de Melville Herskovits qui – entre la fin des années 1920 et les années 40 – fut le premier anthropologue a démontré l’existence de rétentions africaines dans les communautés noires américaines à travers la recherche de terrain (Herskovits 1990). Par le même principe, on peut se demander pourquoi les recherches anthropologiques en France peinent à adopter le concept de diaspora pour penser les communautés antillaises (Chivallon 1997; Gueye 2009) alors que le milieu intellectuel français s’est montré très réceptif aux travaux des chantres de la créolisation et la créolité.
Pour les peuples concernés, se penser en diaspora ou se penser dans la créolité sont des façons – complémentaires pour certains, opposées pour d’autres – de se penser dans le monde, de s’inscrire au sein d’univers historiques et géographiques. Ce sont aussi des stratégies politiques. Ainsi le panafricanisme et la négritude – deux mouvements diasporiques avant l’heure – sous-tendent certains projets de décolonisation dès l’entre-deux guerres (Wilder 2015). En Jamaïque, le nationalisme créole a servi de rhétorique politique pour unifier une nation divisée par sa structure raciale et ses différences ethniques (Bolland 1998; Brathwaite 1971; Thomas 2004). La « nation calalou » de Trinidad suit le même principe (Khan 2004).
Créolité et diasporicité sont pensées de façons complexes et contrastées dans les Antilles françaises. L’histoire intellectuelle martiniquaise offre une lignée : à la négritude de Césaire vont répondre d’abord Glissant avec l’Antillanité et la créolisation puis Bernabé, Chamoiseau et Confiant avec la créolité (auxquels Glissant répondra avec sa poétique de la Relation). En revanche, les choses sont plus compliquées en Guadeloupe où ces concepts – en particulier créolisation et créolité – se heurtent à une pensée nationaliste forte. Ainsi, s’il reconnait l’existence de nombreuses pratiques linguistiques, musicales ou culinaires qui sont des produits de la créolisation, Ti Malo constate que « quand en Guadeloupe on parle de ces aspects-là de notre culture, on ne parle pas de créolité. On parle de fusion, on parle de rencontre entre tradition et modernité, voire on crée une terminologie spécifique. Mais ce n’est pas le terme “créolité” qui est utilisé pour désigner ces éléments » (séminaire « Créolités, Créolisations, Arts et Pratiques socioculturelles », 25 juin 2012). Comme me l’a fait remarquer Marie-Héléna Laumuno, en Guadeloupe, beaucoup cherchent à se « décréoliser ».
Un échange avec Klòd Kiavué permet d’expliquer en partie cette réticence. Alors que je lui avais parlé de la créolité en référence aux albums de David Murray et les Gwo Ka Masters, le percussionniste est allé chercher un dictionnaire qu’il a ouvert à la définition de créole : « personne de race blanche, née dans les colonies intertropicales, notamment les Antilles » (Petit Robert 2006). Il n’est pas étonnant, alors, que Kiavué déclare :
Le truc de la créolité, ça a toujours été un problème pour cette musique-là. Parce que tout le monde n’adhère pas [...] Moi j’adhère pas.
Non seulement la créolité pose problème si on la limite à une définition proche de son sens originel connotant une certaine corruption de la blanchité européenne sous l’effet des climats tropicaux ; mais elle menace aussi une certaine vision nationaliste de ce que forme un peuple. Kiavué continue :
Le mélange, un gars comme Lockel, il te dit aussi : “Si tu es tout le monde, tu n’es rien du tout.” Tu vois un peu, l’idée c’est un peu ça, dire que, bon, nous, on est le monde. Si tu es le monde, t’es rien du tout parce que, jusqu’à maintenant, en Guadeloupe, l’ethnie noire a créé le gwoka, l’a développé et n’a jamais eu droit à la parole. Jusqu’à maintenant, dans l’histoire de la Guadeloupe, l’ethnie noire n’a jamais eu réellement droit à la parole, tu vois, à part de par la musique.
En fait, créolisation et diaspora déstabilisent l’idéal nationaliste (Appadurai 1996, 158-77; Crichlow and Northover 2009, 184) : la créolisation parce qu’elle renie implicitement toute pureté ou essence, l’identique dans l’identité; la diaspora parce qu’elle implique des solidarité et des commonalités qui dépasse le cadre de la nation.
Gérard Lockel entre nationalisme et cosmopolitisme diasporique
Comme le suggère Kiavué, le gwoka modèn illustre bien la tension, dans le milieu du gwoka, entre une idéologie nationaliste et une pratique et une esthétique musicale qui participe à un certain cosmopolitisme diasporique. Cette tension prend racine dans la formulation marxiste du projet nationaliste guadeloupéen. En effet, si les étudiants de l’AGEG ont mis en avant une solidarité de classe (et critiqué Césaire et les écrivains de la négritude pour avoir privilégié la race dans leur analyse culturelle), il n’en reste pas moins qu’en sélectionnant des pratiques culturelles – tel le gwoka, le créole ou les contes – héritées des personnes mises en esclavage, ils ont aussi privilégié une culture guadeloupéenne noire (AGEG 1970; Burton 1993). De même, le mouvement nationaliste guadeloupéen a été empreint d’un certain cosmopolitisme : il est marqué par la circulation des idées marxistes et anticolonialistes dans les milieux estudiantins à Paris suite à la conférence de Bandung, les guerres anticoloniales en Indochine et Algérie, la révolution cubaine, l’émergence du mouvement Black Power aux Etats-Unis et la révolution culturelle en Chine. Il emprunte ainsi certain de ses symboles à ce cosmopolitisme révolutionnaire : le drapeau guadeloupéen proposé par l’AGEG est inspiré du drapeau cubain et les jeunes militants guadeloupéens ont adopté les cheveux naturels et les coupes Afro, signes cosmopolites d’une revendication identitaire noire.

Couverture du rapport du 9ème congrès de l'AGEG (1970).

Première page du mensuel Ja Ka Ta (n°10, avril-mai 1979).
Une analyse des rapports compliqués entre le gwoka modèn et le jazz laisse donc à entendre ces tensions – entre solidarité de classe et solidarité de race, mais aussi entre nationalisme et cosmopolitisme – sans forcément les résoudre. Lockel résume ces tensions dans une déclaration sur les similitudes entre le gwoka modèn et le jazz :
Le haut degré de technicité des différents instruments, la grande place laissée à l’improvisation, le fait d’être une musique de la diaspora noire en terre américaine constituent les points de convergence.
Il ajoute immédiatement :
Mais là s’arrêtent les ressemblances, ces deux musiques, le GWO KA et le JAZZ reposent sur des bases différentes (Lockel 1989).
Cette déclaration juxtapose une reconnaissance d’une esthétique moderniste diasporique partagée et, immédiatement, une rupture de la prémisse même de la diaspora, c’est à dire des bases culturelles communes. Comment comprendre la cohérence de ce double mouvement a priori contradictoire ?
En 1976, lors de la sortie de son premier album, Lockel insiste sur le fait que le gwoka est la musique d’Africains mis en esclavage et de leurs descendants. Mais il affirme aussi que « le problème de classe est fondamental » pour comprendre le processus d’assimilation et la résistance contre elle (Lockel 1976). Pour Lockel, le gwoka est avant tout une musique de la lutte des classes. Or, dans ses écrits, Lockel ridiculise le jazz comme la musique d’intellectuels bourgeois aliénés. Le gwoka modèn a été créé précisément pour combattre cette aliénation. Pour Lockel, le jazz et le gwoka modèn ont donc non seulement des bases nationales différentes (Etats-Unis et Guadeloupe) mais surtout des bases sociales divergentes (Lockel 1989). Cela dit, si le gwoka est une expression musicale prolétarienne au service de la lutte des classes, il est aussi néanmoins une musique noire. Ainsi, dans son autobiographie, le guitariste adopte une essence rythmique noire proche de celle proposée par les grandes figures de la négritude :
Après tout ce que j’ai constaté et vu, après plusieurs expériences, après tout ce que j’ai compris et toutes mes analyses, j’en déduis que le nègre est rythme ; je suis persuadé que nègre et rythme signifient la même chose (Lockel 2011, 179).
Plus loin, il conclut :
Le gwo-ka est et doit rester un art nègre guadeloupéen (Lockel 2011, 243).
Musicalement, le gwoka modèn « domestique » les esthétiques associées à un cosmopolitisme de la diaspora noire pour les rendre compatibles avec son message nationaliste. De cette façon, les gammes pentatoniques (communes aux langages musicaux de la diaspora, du blues aux improvisations de John Coltrane) sont réinventées en la gamme gwoka qui, bien que plus complexe, préserve les sonorités associées aux gammes pentatoniques. Les polyrythmies communes aux musiques noires sont limitées en s’ancrant dans la pulsion du boula, dont les rythmes sont maintenant codifiés. À mon sens, le gwoka modèn opère ainsi un mouvement qui part d’esthétiques communes à un modernisme cosmopolite noir pour arriver à une intimité musicale tournée vers l’intérieur, vers la nation. Les rencontres plus récentes entre le gwoka et le jazz opère le mouvement inverse, de la nation vers la diaspora.
David Murray et les Gwo Ka Masters : Décalages dans l’esthétique du blues
Le groupe David Murray et les Gwo Ka Masters illustre bien ce mouvement centrifuge. David Murray et Klòd Kiavué se sont rencontrés à Paris, où ils résidaient tous les deux, en 1995 lors du festival Banlieues Bleues. La carrière du saxophoniste américain était déjà bien établie et cette période marque pour lui une ouverture vers de nombreuses collaborations qui vont donner à entendre sa propre conception d’une esthétique diasporique noire. Ainsi, à la suite de sa rencontre avec des musiciens sénégalais (Fo Deuk Revue, 1997), Murray se lance avec Kiavué dans un nouveau projet ambitieux qui rassemblent des musiciens américains, guadeloupéens, martiniquais, et Cap-Verdiens. Après une tournée et l’enregistrement de l’album Creole (1998), les deux musiciens décident de limiter leurs ambitions et de se concentrer sur la rencontre entre le jazz et le gwoka. Le groupe David Murray et les Gwo Ka Masters prend ainsi forme autour du noyau formé par Murray, Kiavué et François Ladrezeau. Cette collaboration durera près de dix ans et sera documentée dans trois albums, Yonn-dé (2000), Gwotet (2003) et The Devil Tried to Kill Me (2009), tous trois enregistrés pour Justin Time Records, le label de Murray.
Les musiciens ont ancré leur collaboration dans une esthétique partagée du blues, une trace musicale de la mémoire de l’esclavage. Comme me l’a dit Kiavué :
Ce sont des musiques, on connait l’histoire, des musiques de descendants d’esclaves. La seule différence, comme on dit, il y en a une qui a donné le blues du coton et nous, on a le blues de la canne.
« On jou maten » sur l’album Yonn dé illustre bien comment cette « esthétique du blues » (Jackson 2000) a pu créer un terrain d’entente entre musiciens guadeloupéens et états-uniens. Guy Konket interprète ici sa propre composition. Il entonne le morceau en duo avec le bassiste Santi Debriano, dans un échange rubato tout en mélismes et « blue notes ». Nous naviguons là dans les eaux familières de l’Atlantique Noir de Paul Gilroy. En effet, en parallèle de son étude de la circulation de personnes, d’idées et d’esthétiques qui lient les communautés noires de l’Afrique, des Amériques et de l’Europe, l’auteur britannique propose que, plus que la mémoire d’une patrie perdue ou la rétention de pratiques culturelles, c’est l’expérience commune du racisme structurel qui sous-tend une intimité diasporique (Gilroy 1993). Mais le projet Créole de David Murray nous permet aussi de dépasser ce cadre d’analyse afin de considérer les limites de cette intimité diasporique.
"On jou maten", album Yonn-dé de David Murray & The Gwo-Ka Masters (Justin Time Records, 2000)
Mes conversations avec Kiavué et Ladrezeau, tout comme une écoute même superficielle des disques de Murray avec les Gwo Ka Masters, révèlent que cette collaboration diasporique n’implique pas forcément une familiarité assumée. Comme on peut s’y attendre, les musiciens ont eu du mal à trouver un langage musical commun. D’un côté, les chanteurs et percussionnistes guadeloupéens craignaient que l’imposition d’harmonie de jazz sur leur musique en compromette son intégrité esthétique, que le santiman du gwoka ne se perde. Kiavué m’a ainsi expliqué :
L’histoire d’utiliser les rythmes gwoka avec les harmonies jazz, ça fonctionne pas tout le temps, hein ? Ça peut fonctionner sur le blues. […] Mais on s’est rendu compte tout de suite que si c’est pour coller les harmonies jazz sur le rythme gwoka, c’est pas efficace, quoi. Et ça rend pas non plus, au niveau de l’émotion […]
Murray, pour sa part, ne souhaitait pas se réinventer en musicien de gwoka. Comme il me l’a expliqué, il a préféré utiliser son propre langage musical pour apporter un « vernis jazz » au gwoka. Tout comme la rencontre entre Murray et les musiciens sénégalais a mis en évidence une tension inhérente entre la primauté du rythme dans les musiques sénégalaises et les conventions harmoniques et structurelles du jazz (Mangin 2004), l’alliance entre jazz et gwoka est compliquée : les conventions harmoniques (basés sur l’harmonie soit tonale soit modale) et structurelles (grilles d’accords répétées) du jazz créent une friction avec le langage du gwoka défini par ses rythmes, son langage mélodique divorcé de structures d’accords, et ses structures d’improvisation ouvertes.
Cette friction n’est nulle part mieux illustrée que dans les rencontres entre Murray et Gérard Lockel. Murray avait souhaité recruter Lockel pour son projet initial mais le guitariste a refusé de se joindre à un groupe qui n’adhérerait pas à sa vision musicale. De même, le saxophoniste ne souhaitait pas s’investir dans l’apprentissage du système de Lockel. Les deux musiciens se sont néanmoins rejoints en studio pour l’enregistrement de deux morceaux : « Guadeloupean Sunrise » et « Guadeloupean Sunset ». Ces deux improvisations démontrent tout d’abord que les frictions esthétiques entre gwoka modèn et jazz peuvent être créatives lorsqu’elles sont nourries par un attachement commun à une avant-garde musicale noire. Elles illustrent la conclusion de l’ethnomusicologue Veit Erlmann qui propose que les dialogues entre musiciens de la diaspora africaine soient « essentiellement phatiques », c’est à dire qu’ils donnent avant tout à entendre la rencontre, à établir un rapport, ce qu’Erlmann appelle une « communauté de style » (Erlmann 2003). Mais ici, nous percevons aussi les limites que créent les frictions esthétiques au sein de la diaspora : la communauté de style est elle-même marquée par la difficulté à s’accorder sur un langage musical commun au-delà de la liberté offerte par l’abandon de toutes conventions au profit d’une écoute aussi libre qu’attentive.
"Guadeloupe sunrise", album Creole de David Murray (Justin Time Records, 1998)
Il faut aussi reconnaitre que l’intimité musicale diasporique au sein des Gwo Ka Masters est traversée par des différences de pouvoir économique importantes, les musiciens guadeloupéens n’ayant pas du tout la même position vis-à-vis de l’économie politique musicale que David Murray. Ceci est particulièrement vrai dans la relation aux modes de production et de diffusion d’enregistrements, Murray ayant le contrôle des procédés d’enregistrement. Ceci a d’importantes conséquences sur l’esthétique des albums. Force est de constater qu’au cours de la décennie de collaborations entre Murray et le Gwo Ka Masters, les marqueurs d’une spécificité musicale guadeloupéenne se sont progressivement estompés dans le mix de chaque album.
Le premier album du groupe était organisé autour de la voix et de plusieurs compositions de Guy Konket, allant jusqu’à reprendre ses propres arrangements. On peut, par exemple, comparer la version de « YouYou » sur Yonn-dé avec celle enregistrée en spectacle pour Guy Konket et le Groupe Ka (Editions Bolibana, BIP-96, ca. 1981). Le résultat est un album entièrement chanté en créole et dans lequel les rythmes du gwoka sont proéminents et facilement reconnaissables.
"Youyou", album Yonn-dé de David Murray & The Gwo-Ka Masters (Justin Time Records, 2000)
"Youyou", par Guy Konket et le Groupe Ka (Editions Bolibana, ca. 1981)
Le deuxième album, Gwotet, change assez radicalement d’esthétique. Konket est absent et le saxophoniste Pharoah Sanders – ancien compagnon de John Coltrane – est invité sur trois morceaux. Le groupe est aussi rejoint par une section de musiciens cubains (trompettes, trombone, saxophones). Le résultat est un album où le créole marque un net recul et où les rythmes et le son même des tambours guadeloupéens peinent souvent à se faire entendre parmi la texture sonore épaisse et la rythmique assise par le batteur Hamid Drake et le bassiste Jaribu Shahid. Le « vernis jazz » menace déjà d’obscurcir la base gwoka de la musique.
"Gwotet", album Gwotet de David Murray & The Gwo-Ka Masters (Justin Time Records, 2003)
Ce tournant s’accentue avec le troisième album, The Devil Tried to Kill Me. L’album fut enregistré en Guadeloupe en 2008 avec un groupe qui, initialement, comprenait l’accordéoniste de quadrille Négoce. Le mixage, sous la direction de Murray, pris plus de deux ans. Pendant ce procédé, le saxophoniste décida d’abandonner les pistes enregistrées par Négoce. À leur place, il fit appel au musicien de blues Taj Mahal et à la chanteuse Sista Kee pour ajouter des chants en anglais basés sur des poèmes d’Ishmael Reed sur la moitié des morceaux. Le résultat est un album chanté quasi entièrement en anglais et dans lequel les influences funk – déjà très présentes sur Gwotet – masquent presque complètement les éléments distinctivement guadeloupéens.
"Southern skies", album The Devil Tried to Kill Me de David Murray & The Gwo-Ka Masters (Justin Time Records, 2009)
Il serait trop facile de critiquer la mainmise de Murray sur les enregistrements des Gwo Ka Masters. Ce serait perdre de vue le désir, sans aucun doute sincère, qu’exprime David Murray de promouvoir le gwoka – et les carrières de ses collaborateurs guadeloupéens — sur la scène internationale. Il vaut mieux, à mon sens, voir dans cette collaboration une illustration de la complexité et des décalages inhérents aux échanges musicaux au sein de la diaspora africaine, elle-même traversée par des relations de pouvoirs économiques stratifiées, des enjeux politiques discordants entre ces différentes communautés, et des esthétiques qui, bien que construites sur des bases communes, explosent en différences distinctives.
Jazz Ka : Créolisation de la diaspora
La collaboration entre Murray et les Gwo Ka Masters nous rappelle donc que la diaspora est une formation dynamique et instable, donc ouverte aux processus de créolisation (Crichlow and Northover 2009). J’entends dans la musique de Jacques Schwarz-Bart cette intersection entre diaspora et créolisation et, donc, une autre manière de se penser dans le monde.
Le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart est le fils des écrivains Simone et André Schwarz-Bart. Elle est guadeloupéenne ; lui, suisse et juif. Comme le saxophoniste lui-même le fait souvent remarquer, il habite donc l’intersection de deux diasporas. En 2002, Jacques Schwarz-Bart participa à l’enregistrement de l’album de Franck Nicolas qui inaugura le concept de jazz ka.
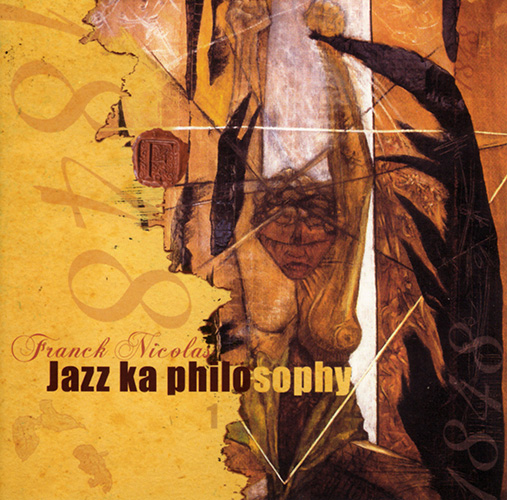
Couverture de l'album Jazz Ka Philosophy de Franck Nicolas (2002).
Quatre ans plus tard, en 2006, Jacques Schwarz-Bart sortit Soné Ka-La, son premier album en leader, donnant ainsi à entendre sa propre version du jazz ka. Au fil des années, une série d’enregistrements ont suivi qui donnent littéralement à entendre la diaspora africaine : un deuxième album jazz ka, un album aux influences neo-soul marquées, un album straight-ahead, un album basé sur la mizik rasin haïtienne. À cela viennent s’ajouter sa participation aux groupes des musiciens américains Roy Hargrove et Meshell Ndegeocello, un partenariat avec le pianiste cubain Omar Sosa, des rencontres avec des musiciens gnaouas du Maroc et sa participation au disque Creole Soul du trompettiste trinidadien Etienne Charles. Plus récemment, Jacques Schwarz-Bart a publié l’album Hazzan, sur lequel il connecte cultures juives et caribéennes, avant de retrouver le jazz ka sur Soné Ka-La 2 (Odyssey). Dans une vidéo promotionnelle pour Hazzan, le saxophoniste se définit à travers cette anecdote :
Dans un des livres posthumes de mon père – qui s’appelle L’Étoile du matin – il y a un personnage qui étrangement me ressemble. C’est un musicien de jazz qui est juif et noir et qui se définit comme 200%. C’est-à-dire non pas moitié juif, moitié noir, mais 100% l’un et l’autre. Et c’est un peu comme ça que je vis mes identités, et donc mon identité juive. C’est-à-dire dans un dialogue constant avec tout ce qui représente l’humanité. (https://youtu.be/7-zBwYUYZ5k?t=130)
Nous le voyons bien, Jacques Schwarz-Bart refuse de réduire sa musique à l’expression d’une identité unique. Ainsi, son intérêt pour le gwoka ne reflète aucunement un attachement nationaliste. Plus qu’une identité communautaire, c’est une « identité émotionnelle » que le saxophoniste met en avant (Schwartz-Bart 2014) et sa musique est animée par des souvenirs et des connections affectives plus que par une quête d’authenticité. Par exemple, c’est les disques qu’il a entendus en grandissant et le souvenir de sa mère chantant ces mélodies qui ont inspiré l’album Jazz Racine Haiti. La musique de Jacques Schwarz-Bart habite et construit ce que la chercheuse Nadia Ellis appelle des « territoires de l’âme », des espaces affectifs diasporiques qui sont « à la fois imaginés et matériels » (Ellis 2015).
Le diptyque musical que Jacques Schwarz-Bart a dédié à ses parents sur l’album Abyss illustre, pour moi, cette identité à 200%. La première partie, simplement intitulé « André », offre une sorte de kaddish musical, une prière à la mémoire de l’écrivain récemment décédé et rendu à travers un duo méditatif entre le pianiste Milan Milanovic et le saxophoniste. Le rire doux de Simone Schwarz-Bart ouvre la deuxième partie, construite autour d’une lecture d’un de ses poèmes en créole. Le poème est une ode aux enfants ki fèt an doukou pèdi, les enfants de la nouvelle lune, enfants nés dans la liminalité entre l’ancien et le nouveau, au croisé des cultures.

Couverture de l'album Abyss de Jacques Schwarz-Bart (Universal Music Jazz France, 2008).
Jacques Schwarz-Bart est lui-même un enfant de la nouvelle lune, un musicien au centre d’un tissu connectif aux possibilités infinies, selon ses propres mots. Sa musique tisse les différents fils de son identité : caribéen, juif, français, noir et, depuis de nombreuses années, New Yorkais. Cependant, à l’écoute de ses disques, on est avant tout frappé par la grande cohérence et continuité esthétique entre les différents projets. L’accent émotionnel peut se déplacer du gwoka guadeloupéen vers le R&B américain, le vodou haïtien ou les musiques juives mais il n’y a pas de ruptures dans l’esthétique musicale : le vocabulaire et l’instrumentalisation coulent d’un projet à un autre. Ainsi les mélodies des compositions du saxophoniste jouées à l’unisson entre voix et saxophone se retrouve sur la plupart des disques. Les accents caribéens continuent d’accompagner la liturgie juive sur Hazzan.
Dans la musique de Jacques Schwarz-Bart, les enchevêtrements diasporiques sont diffus. Au sein de groupes qui rassemblent des musiciens New-Yorkais, guadeloupéens, haïtiens et sénégalais, le saxophone de Jacques Schwarz-Bart et ses invocations d’une spiritualité à la fois juive et afro-caribéenne fonctionnent comme un point d’articulation entre plusieurs ancrages géographiques (New-York, Guadeloupe, Haïti, mais aussi Paris ou la Suisse natale de son père) et les différentes facettes de son identité à 200%. La musique de Jacques Schwarz-Bart résiste à tout attachement envers une patrie unique ou une identité singulière.
À travers sa musique, Jacques Schwarz-Bart opère aussi un recentrage de la diaspora africaine vers la Caraïbe, comme lorsqu’il établit la musique haïtienne comme un des points d’origine à la fois du jazz et du cubisme ou quand il met la biguine et le jazz de la Nouvelle-Orléans en rapport l’un envers l’autre, comme il l’a fait lors d’un entretien avec la journaliste Elsa Boublil sur France Musique en 2014. Ainsi, c’est une « créolisation de la diaspora » qu’offre la musique de Jacques Schwarz-Bart (Crichlow and Northover 2009).
Une grande distance idéologique et esthétique sépare la musique de Gérard Lockel de celles des Gwo Ka Masters ou encore de Jacques Schwarz-Bart et Franck Nicolas. Lockel part d’une position anticoloniale et nationaliste. Sa musique manipule les conventions esthétiques d’un cosmopolitisme moderniste noir pour s’en distancer et les nationaliser. C’est un mouvement qui rejette l’idée même de créolité (antithétique à une essence nationale guadeloupéenne) et qui part de la diaspora pour se recentrer sur la nation. A travers leur collaboration avec David Murray, les Gwo Ka Masters opèrent un mouvement opposé qui reconnecte le gwoka aux musiques de la diaspora africaine.
Nicolas et Schwarz-Bart font partie d’une autre génération et le jazz ka émerge d’un paradigme politique et culturel très différent du gwoka modèn. Ils bénéficient des acquis culturels du mouvement nationaliste des années 1970-80 alors même qu’ils vivent une période de désenchantement envers les promesses et espoirs nationalistes. Contrairement à leurs ainés, ils assument leur métissage et l’ambiguïté de leur situation postcoloniale. Dans un entretien en 2010, Frank Nicolas me déclarait qu’il se sentait « black issue de l’esclavage, comme les Américains qui sont comme nous ». Cette vision diasporique nourrit son approche du jazz ka, une approche dans laquelle le jazz ouvre la porte à une diffusion internationale du gwoka — comme c’est le cas pour Murray et les Gwo Ka Masters. En 2010, cependant, Nicolas expérimentait aussi avec un groupe dédié au répertoire de la chanson française. Alors que je l’interrogeais sur ce projet, il m’expliqua : « Ma mère est française, mon père est guadeloupéen. Je revendique aussi ce côté-là. La France, c’est ma moitié, c’est ma mère ». Comme Schwarz-Bart, Nicolas affirme une identité multiple. De même, il résiste à toute lecture totalisante de sa musique. En 2010, il concluait ainsi notre conversation :
Mon travail représente une facette de mon pays. Il y a personne qui peut dire que son travail représente la Guadeloupe. Mais par contre, on peut dire que… Par exemple, Gérard Lockel, dans sa musique, il y a un aspect de la Guadeloupe. Schwarz-Bart, il y a un aspect de la Guadeloupe qui ressort. Alain Jean-Marie, il y a encore un autre aspect de la musique qui ressort. Et moi je pense aussi : il y a un aspect de la Guadeloupe qui ressort dans ma musique. Et c’est naturel en fait.

Franck Nicolas au Petit Journal Montparnasse (Paris) en 2016, avec Sonny Troupé à la batterie.
© Jérôme Camal
Cette exploration des tensions entre nationalisme, diasporicité et créolité peut sembler inutilement philosophique. Il faut néanmoins souligner qu’au-delà des questions identitaires, se jouent dans les rencontres entre jazz et gwoka des enjeux économiques réels. Certes le déploiement ou le rejet des esthétiques « jazz » dans le gwoka expriment des pensées politiques divergentes ainsi que différentes façons de « vivre-au-monde », selon l’expression de Patrick Chamoiseau, de se penser dans l’espace national, postcolonial, diasporique, ou créole. Mais elles impactent aussi la circulation matérielle de la musique et l’intégration des musiciens de gwoka dans un marché culturel transatlantique si ce n’est mondialisé. Ainsi, la musique de Lockel, en ce début de XXIème siècle, circule peu en dehors de la Guadeloupe, et même en dehors de la communauté assez restreinte qui continue de soutenir le guitariste. Par contraste, David Murray est intégré depuis de nombreuses années déjà dans le marché international du jazz : il a relativement facilement accès aux scènes des festivals et clubs de jazz ; sa musique bénéficie d’une bonne diffusion dans les magasins spécialisés et, maintenant, sur les plateformes digitales de streaming.
Pour des musiciens tels Schwarz-Bart ou Nicolas, s’inscrire dans une communauté diasporique avec les musiciens de jazz états-uniens, est aussi une manière de se situer au sein de la géographie des musiques noires en France. En effet, trop exotiques pour être classés dans les rayons de musique française d’un magasin de disque comme la FNAC, les musiques antillaises (que ce soit le gwoka, la biguine, ou le zouk) se retrouvent généralement cantonnés aux rayons « musiques du monde », classification qui ne porte pas le même capital culturel que le jazz. En se positionnant comme musiciens de jazz, Schwarz-Bart, Nicolas et de nombreux autres cherchent à intégrer une catégorie plus prestigieuse dans les distinctions faite entre musique « pop » et musique perçue comme plus savante et artistique ; une catégorie qui plus est, constitue un réseau de festivals, salles de concert, distribution d’enregistrements, presse spécialisée bien établi en France. Malheureusement la catégorie n’est pas forcément ouverte aux musiciens de musiques improvisées venant des Antilles, ceux-ci offrant une musique qui tombe entre les esthétiques associés aux styles nord-américains (swing, bebop, hard bop, etc.) et celles empreintes de musique contemporaine promulguées par les musiciens européens depuis les années 1970 (dont Michel Portal ou Louis Sclavis sont deux figures emblématiques en France). Ainsi, en 2016, j’ai eu le plaisir d’écouter les groupes de Mario Canonge et Franck Nicolas au Petit Journal Montparnasse à Paris, lors d’un festival au titre ironique : « C’est pas du jazz ». Malheureusement, deux ans plus tard, l’ironie fit place à la colère et la tragédie lorsque Franck Nicolas, ayant récemment perdu son statut d’intermittent du spectacle, déclara une grève de la faim pour attirer l’attention sur le sort des musiciens antillais qui, comme lui, se retrouvent exclus de la programmation des festivals de jazz. « Quand j’envoie un CD à un programmateur, on me rétorque que ce n’est pas du jazz. Les Antillais ne sont crédibles que dans des rôles d’amuseurs, comme Francky Vincent ou La Compagnie Créole. Mais la carte postale, y’en a marre, » déclara Nicolas à un journaliste de Télérama (Delhaye 2018). De nombreux autres musiciens antillais, dont Jacques Schwarz-Bart ou Mario Canonge, sont vite venus appuyés ses accusations de discrimination. Ainsi, Magic Malik (Malik Mezzadri) expliqua au même journaliste :
La génération des Daniel Humair et Louis Sclavis s’est approprié le jazz en France. Ils ont fait de belles choses, mais on a occulté, au passage, les particularités des approches relevant de la diaspora – et c’est d’autant plus désolant que ces particularités ont influencé le jazz américain. En France, le jazzman antillais reste enfermé dans le jazz caribéen. L’artiste n’a aucune possibilité d’accéder à une envergure nationale quand il est issu d’une colonie.
En 2022, il semble que la situation ait évoluée. L’attribution du prix « Révélation » au batteur guadeloupéen Arnaud Dolmen aux Victoires du Jazz 2022 nous le donne en tous cas à espérer. Mais on voit que, une fois encore, les esthétiques musicales et les questions identitaires forment de complexes enchevêtrements et façonnent l’économie politique culturelle dans la France (post)coloniale.
______________________________________
SOMMAIRE
1. Introduction. Le gwoka, un champ aural d'engagements politiques complexes
2. Tambour et auralité coloniale
3. Le gwoka comme auralité anticoloniale
4. Les deux créolisations de Guy Konkèt
5. Jazz et gwoka : Auralité créole ou diasporique ?
6. Le gwoka dans une auralité postnationaliste
Illustrations musicales
Bibliographie
Conférence audio
______________________________________
par Dr Jérôme Camal
© Médiathèque Caraïbe / Conseil Départemental de la Guadeloupe, juillet 2022

